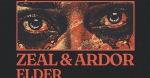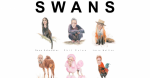C'est la fête nationale belge : 10 albums belges à écouter hein, fieu
lundi 21 juillet 2025
L'autre belge de la rédac'. Passé par Spirit of Metal et Shoot Me Again.
Ça ne vous a pas échappé : Horns Up a une petite teinte belge. Deux membres de cette rédaction – votre serviteur et Matthias – disent nonante et septante, n'ont pas encore décapité leur Roi et jouent aux fléchettes sur le portrait de Samuel Umtiti. Rajoutez à ça le fait qu'un autre de nos rédacteurs s'est exilé à Bruxelles parce que quitte à vivre dans une capitale sale et mal branlée, autant que la pinte y soit moitié moins chère, et vous comprendrez pourquoi Horns Up couvre un peu plus les concerts et festivals belges que la moyenne des webzines hexagonaux.
Mais ce lundi, c'est l'occasion d'aller plus loin : le 21 juillet, c'est en effet la fête nationale belge, et on a voulu y participer à notre manière. Horns Up vous propose donc une liste totalement subjective, entre classiques relatifs, perles oubliées et choix du moment. Certains groupes considérés comme incontournables seront contournés parce qu'ils ne correspondent tout simplement pas à nos goûts (on pense à une bonne partie de la scène hardcore et à presque toute la scène black, qu'on voit au final bien plus souvent en concert qu'on l'écoute chez nous), ou parce qu'on a préféré vous faire découvrir des choses parfois plus méconnues. Bref : voici 10 albums à écouter, et pas qu'une fois !
Blast – Damn Flame/Hope (1973)
Et si on vous disait que le premier blast-beat de l'histoire du rock (et de ses descendants) avait résonné dans le Borinage ? Plus précisément du côté de Hornu, où Michel Jacobs, Toni Colonius et Antoni Cucciara forment Blast (un nom prédestiné !) en 1971. Le temps d'une démo de deux titres, et Blast splitte à la suite du départ pour le service militaire de Colonius (basse-chant), laissant derrière eux... les premiers morceaux de punk hardcore de l'histoire ? Cinq ans avant la formation des Bad Brains, près de dix ans avant le premier album de Discharge, Blast, probablement sans vraiment s'en rendre compte, est en avance sur son temps. En avance sur le D-beat, sur le hardcore, sur le thrash, sur Motörhead. « Damn Flame » et « Hope » ne sont pas pour autant des « grands » morceaux (même s'il s'en dégage une énergie terrible), mais en dehors du chant proto-punk et encore fort psychédélique de Colonius, bonne chance pour deviner à l'aveugle la date de leur enregistrement. Et pour le détail franchement cocasse : l'homme derrière les fûts, Michel Jacobs, n'a pas arrêté la musique après Blast puisqu'en octobre 77, il entre en studio... avec Claude François, pour lequel il enregistre quelques parties et avec qui il devait partir en tournée. Le décès de Cloclo en a décidé autrement, et depuis, après avoir collaboré avec Plastic Bertrand ou encore Lou Deprick, « l'inventeur » du punk hardcore joue dans un groupe de covers en Belgique !
Ostrogoth – Ecstasy & Danger (1983)
Vous l'aurez compris en voyant le nom du rédacteur responsable de cette liste : oui, le heavy et sa périphérie y seront un poil surreprésentés. Ça tombe bien, la Belgique compte quelques groupes tout à fait recommandables dans le genre, et Ostrogoth en est bien sûr la tête de gondole. Ecstasy & Danger s'ouvre sur la véritable merveille « Queen of Desire », qui me fait inévitablement penser au Queensrÿche de la même époque pour ces huit minutes d'envolées vocales à la Tate et de bridge planant et progressif. Le reste de l'album est plus frontal, n'atteint jamais le niveau immaculé de ce premier titre mais reste un classique un peu trop méconnu du heavy des 80s (« Ecstasy & Danger », le très NWOBHM « Stormbringer »). James Hetfield lui-même fait régulièrement la pub d'Ostrogoth à coups de t-shirts et de patchs de ce qui reste probablement LE groupe belge dans le genre – toujours actif et excellent en 2025 malgré des changements de line-up interminables et le triste décès de leur génial guitariste Rudy Vercruysse en 2015. Dix ans plus tard, on ne peut pas faire sans lui rendre hommage.
Steelover – Glove Me (1984)
Avant Dirk Verbeuren, probablement à l'heure actuelle le musicien metal belge doté du plus beau CV (Megadeth, Devin Townsend, ex-Soilwork de 2005 à 2016, excusez du peu), il y avait Rudy Lenners. Le natif de Seraing a martelé les fûts de Scorpions de 1975 à 1977, enregistrant notamment In Trance et Virgin Killer, et la voix de crécelle de Vince Gillard sur ce Glove Me ne sera donc pas la seule référence aux Allemands. Longtemps seul album de Steelover, Glove Me n'est peut-être pas un indispensable mais sera une écoute tout sauf désagréable pour tous les fans de la early NWOBHM, mâtinée de ce côté si catchy et léger propre au sleaze/glam qui explosait alors. Sans réussir à s'inscrire dans la durée, Steelover a ses grands moments, comme les immenses tubes « Give it Up » et surtout « Need the Heat ». Notons qu'avant leur split-up, Dani Klein, future vocaliste de Vaya Con Dios avec qui elle rencontrera un tout autre succès (dans un tout autre style), enregistrera avec Steelover un album qui ne verra jamais le jour, mais dont des extraits sont accessibles sur le net...
Cyclone – Inferior to None (1990)
Le thrash belge a connu ses heures de gloire, et depuis le revival du genre, il a également son petit succès – vous connaissez certainement Channel Zero et Evil Invaders, qui m'en touchent une sans remuer l'autre, mais j'y ajouterais les tout jeunes Cobracide ou le black/death'n'roll pas très malin de Slaughter Messiah, dans un genre différent. En 1986, Cyclone sortait Brutal Destruction, peut-être l'un des condensés de riffs les plus punitifs du style, rien que ça. Si l'enregistrement a un peu vieilli, les titres de cet album prennent une dimension délirante en live : j'ai vu Cyclone deux fois récemment, j'ai pris deux claques monumentales. Sur album, par contre, je ne peux que vous conseiller le second (et donc dernier) album de Guido Gevels et sa bande, Inferior to None, qui n'a pas pris une ride. Exit le pur thrash/speed sans concessions : on est en 1990, et le tout « rebondit », groove (le mot est lâché) un peu plus. Les ambiances varient (« So Be It » et son côté Ride the Lightning ), rendant chaque accélération encore plus ravageuse. Les riffs restent bien sûr absolument venimeux (« Paralysed »), mais Cyclone affine sa formule, vous incruste des refrains (« Neurotic ») et compose peut-être bien son meilleur titre avec « I Am the Plague ». La voix de Guido Gevels trouve également son style ici, loin du chant thrash habituel, plus proche d'une sorte de hardcore, qu'il a gardé jusqu'à aujourd'hui en live – il est le dernier membre d'origine et Cyclone, reformé en 2019, n'a encore rien sorti depuis cet Inferior to None qui mérite bien son nom. Fans d'Exodus, Coroner ou Heathen, ne passez pas à côté !
Mystery – Mystery (1991)
On vous a parlé il y a peu du Heavy Sound Festival sur Horns Up. De 1983 à 1985, ce festival légendaire s'est tenu à Poperinge, accueillant la crème belge de l'époque (dont Ostrogoth) mais aussi et surtout une belle galettede (futurs) géants du genre : Uriah Heep, Gary Moore et Baron Rojo en 1983, Metallica, Twisted Sister, Motörhead et Mercyful Fate en 1984 (ainsi que Manowar qui a annulé, déjà à l'époque...), ou encore Slayer pour leur premier concert européen en 1985 : du délire. Les lecteurs du live-report le savent déjà : cette année, pour les quarante ans du festival, en plus de quelques « vieux de la vieille », le Heavy Sound accueillait une reformation exceptionnelle de Mystery. Et pour moi, ça a été l'occasion de découvrir cet album éponyme sorti de nulle part en 1991 et si peu ancré dans son époque : Mystery, c'est la réponse belge à Journey ou Foreigner. Un album qui serait probablement devenu légendaire et aurait vendu des brouettes d'exemplaires s'il était sorti sept ans plus tôt, tant les incroyables tubes « Please Don't Leave Me Now », « Land of Mystery » ou « Fata Morgana » n'ont rien à envier au meilleur de l'époque, et je n'exagère pas. Malheureusement, la vague grunge arrivera quelques années plus tard et tuera Mystery dans l'oeuf. Jusqu'à cette année !
Arkangel – Dead Man Walking (1999)
Changement d'ambiance et non des moindres. Ce n'est pas mon univers mais même moi, je sais que la Belgique a toujours été un terreau fertile pour le hardcore et surtout le metalcore – celui des 90s, qui mélange le thrash metal au hardcore, avant l'apparition dans la décennie suivante du metalcore mélodique à la Trivium et Killswitch Engage. La France a Kickback, la Belgique a Arkangel : riffs à la Slayer (influence ouverte et assumée du groupe dès ses débuts), chant et thèmes haineux bien loin – du moins sur ce Dead Man Walking – de la moindre idée sociale ou positive, breakdowns à en démolir votre salon. « Harbinger of Doom », « Behold the Face of Death », « Fearful Eyes » et son final stupide au possible : bienvenue chez les fous, tout ici évoque l'aliénation, la purge par le feu. Arkangel n'a peut-être jamais aussi bien sonné que sur cet album, mais est resté d'une solidité et d'une intégrité à toute épreuve, et tourne toujours – avec à la basse et à la guitare Clément et Julien de Hangman's Chair.Même les Français viennent voir comment on fait la bagarre à Bruxelles.
Amenra – Mass IIII (2008)
On a hésité à vous faire une liste dépourvue des noms les plus évidents, auquel cas Amenra, qui ravage les fins de soirée de festival depuis quelques années déjà, aurait été laissé de côté. La Church of Ra, cependant, est tout bonnement incontournable, et peu de groupes en Belgique peuvent enchaîner cinq soirs à guichets fermés à l'Ancienne Belgique. Amenra, en France comme chez nous d'ailleurs, a vraiment explosé aux oreilles du « grand » public avec l'extraordinaire Mass VI, porté par la mélopée glaçante « A Solitary Reign ». Et bien sûr, que Mass VI est un tout grand album, qui a changé les choses et restera probablement comme le climax créatif de Colin Eeckhout. Mais pour toucher au désespoir viscéral et à ce qu'Amenra peut avoir de plus noir, et qui représente encore aujourd'hui les moments les plus poignants du groupe en concert, il faut retourner aux albums précédents. Mass IIII est peut-être le plus fort de tous, entre l'agression des débuts et, déjà, la science folle des changements d'ambiance (« Silver Needle, Golden Nail »). « Razoreater » est peut-être encore aujourd'hui le plus grand morceau d'Amenra, avec un final d'une intensité presque pénible. Le vide vous avale au fil de l'écoute de Mass IIII : aucune lumière, juste une douleur cathartique, qui explose dans cette triplette finale « Razoreater-Aorte. Nous sommes du même sang – Thurifer. Et Clamor Ad te Veniat », indépassable.
Epysode – Fantasmagoria (2013)
La Belgique a aussi son Arjen Lucassen, et donc par extension son Ayreon. Samuel Arkan a fondé Epysode peu de temps avant le split de son groupe principal, qui avait connu son petit succès à l'époque où le power-prog était à la mode : Virus IV. Un groupe où on retrouvait notamment Magali Luyten, qui passera par la suite au micro des Français de Nightmare. Mais plutôt donc que Virus IV, je souhaitais donc évoquer ici Epysode, qui sort son premier album Obsessions en 2011 avec déjà quelques invités de marque, notamment Kelly « Sundown » Carpenter (Adagio, ex-Beyond Twilight, ex-Firewind) et Rick Altzi (Masterplan, At Vance). Deux ans plus tard, il magnifie une formule que vous pouvez imaginer rien qu'à la lecture du casting – un power progressif mélodique et mâtiné de claviers, plus sombre et emphatique que lumineux – et sort l'excellent Fantasmagoria. Là, une règle se confirme : aucun album n'est loupé quand Tom Englund est au chant. Le frontman d'Evergrey livre sur Fantasmagoria l'une des meilleures mais peut-être plus méconnues performances de sa carrière (« The Arch », le très beau duo « Fantasmagoria » avec Ida Haukland de Triosphere). Il est loin d'être seul à briller, Haukland s'offrant peut-être le meilleur refrain de l'album (« Morning Rose ») et Henning Basse (Mayan) ne déméritant pas sur le plus lourd « Venom ». Fantasmagoria est un poil trop long, comme souvent dans le genre, mais même douze ans plus tard, les qualités de compositeur d'Arkan permettent à Epysode de rester pertinent malgré un style un peu tombé en désuétude. Et Samuel a annoncé en ce début d'année qu'il prévoyait de ressortir de la musique en 2025 : on a assez hâte.
Emptiness – Not for Music (2017)
L'OVNI de cette sélection, et celui qui est certainement le plus éloigné du metal. Pourtant, Emptiness a été fondé par deux ex-membres d'Enthroned (l'un des grands absents de notre shortlist), et a commencé sa carrière en faisant, globalement, du metal extrême assez expérimental mais toujours assez brut. Puis, dès le magistral Nothing But the Whole (2014) – dont je ne peux que vous conseiller l'écoute également – s'entamait la mue, poursuivie sur Not for Music. Post-punk, atmosphères à la fois urbaines et gothiques, désespérées. La mélopée de « Meat Heart », toute en fausse légèreté, vous enveloppe pour vous attirer dans d'inquiétants sous-sols hantés : tout l'album s'y déroulera, de pièce en pièce, comme dans un ruin bar où s'agitent les participants à cette rave post-punk. Emptiness est encore parfois vaguement metal (la distorsion finale de « It Might Be », le final bien plus énervé « Let If Fall » où l'on distingue même de vrais riffs et de la double pédale), ne serait-ce que par le chant mi-grogné mi-murmuré de Jérémy Bézier qui peut parfois évoquer ce qui se fait en Pologne (Furia en tête), mais n'en a plus besoin. Not for Music est la bande-son d'un survival horror urbain, expérimental sans se (ni nous) perdre – Vide, sorti en 2021, ira encore plus loin dans le processus en allant presque chasser sur les terres des Discrets, voire de Dernière Volonté, sans vraiment trouver son public. On espère cependant qu'Emptiness reviendra. Le vide est si beau.
Bütcher – 666 Goats Carry My Chariot (2020)
« Wielding the blades of the Speed Metal wheel, it's the power you feel, the power of STEELE !!! » : un album s'ouvrant sur un refrain aussi débile que celui de « Iron Bitch » ne peut qu'être un classique. Je ne vais pas forcément passer des heures à vous parler de Bütcher, tant le combo anversois a rapidement trouvé son public en France autant que chez nous. Et comment pourrait-il en être autrement ? Un speed metal balancé pied au plancher, des rimes en steel, des références bien grasses (« Faster than a laser bullet – 45 RPM METAL ! »), et même le culot de balancer un titre éponyme mid-tempo à la Bathory avec une classe qui fait presque oublier le côté presque parodique du tout. Bütcher est d'ores et déjà un grand classique de la scène belge, et On Fowl of Tyrant Wing (2024) n'a pas démérité par la suite. Un seul conseil à vous donner : allez voir la bande à Hellshrieker sur scène, car c'est là qu'elle prend toute son ampleur. Nos excuses à une bonne partie de la scène black/black'n'roll metal belge un peu passée sous silence dans cet article, mais il faut bien le dire : dans la rubrique steak-frites à bracelets cloutés, le Royaume sait y faire.
Supplément frites :
Acid – Maniac(1984) : un incontournable du heavy/speed non pas belge mais européen. Dès 1983, Acid fait de Kate de Lombaert l'une des premières vocalistes du style. Pousse-toi de là, Doro, voilà la vraie Metal Queen : « Max Overload », « Maniac », « Bottoms Up », « Prince of Hell & Fire » – imparable, et le premier album vaut tout autant l'écoute. Ça ne gâche rien : la soixantaine bien entamée, Madame De Lombaert emmène toujours son Kate's Acid en live avec la même classe.
Enthroned – Towards the Skullthrone of Satan (1997) : je confesse avoir écouté assez peu d'Enthroned, qui n'a pas sculpté mes goûts en matière de black metal – la faute à des sorties mollassonnes au moment où je me mettais à écouter ce style, dans les années 2010. Puis, à rebours, j'ai écouté le « vrai » Enthroned, que Lord Sabathan a quitté en 2016 – il est désormais la force motrice de Slaughter Messiah, valeur sûre des scènes belges, et joue du earlyEnthroned avec Sabathan en live. L'Enthroned, entre autres, de ce Towards the Skullthrone of Satan ou de son prédécesseur, Prophecies of the Pagan Flame (1995). Soyons concis : il ne s'est rien fait de mieux en black metal occulte « à la norvégienne » dans nos contrées. N'en déplaise aux innombrables copycats qui pullulent depuis...
Oathbreaker – Rheia (2016) : véritable étoile filante issue de la Church of Ra, Oathbreaker a sorti trois albums mais a surtout tout détruit avec Rheia, perle émotionnelle de post-hardcore habité, brutal mais délicat, fragile mais puissant, porté par l'immense Caro Tanghe. Ce que le style, avec toutes ses outrances, a pu faire de mieux : presque dix ans plus tard, Oathbreaker reste terriblement pertinent. On espère un retour, mais le hiatus dure depuis plusieurs années maintenant.
Possession – Exorkizein (2017) : peut-être ce que la scène black/death belge a offert de plus puissant, et il faut dire qu'elle est prolixe. Sans la moindre concession, et un album qui a fait de Possession la référence inévitable de tous les Nidrosian Black Mass de Bruxelles (ils sont annoncés pour l'édition de la « renaissance », annoncée en février 2026). Huit ans maintenant qu'on attend son successeur !
Déhà – À Fleur de Peau V : At the Poles of Everything (2023) : Soixante-trois. Voilà le nombre de projets ou groupes référencés par Encyclopedia Metallum auxquels Déhà participe, a participé ou même, souvent, dont il est le seul compositeur. Une production qui force le respect autant qu'elle rend la carrière d'Olmo Lipani difficilement lisible, puisqu'elle va du drone au heavy épique en passant par le death et, en majorité tout de même, le black sous toutes ses formes. La porte d'entrée idéale vers l'univers de Déhà est peut-être sa série À Fleur de Peau, des albums de post-black teintés de shoegaze, entre lumière sombre et mélancolie. At the Poles of Everything est déchirant de bout en bout.