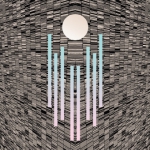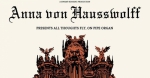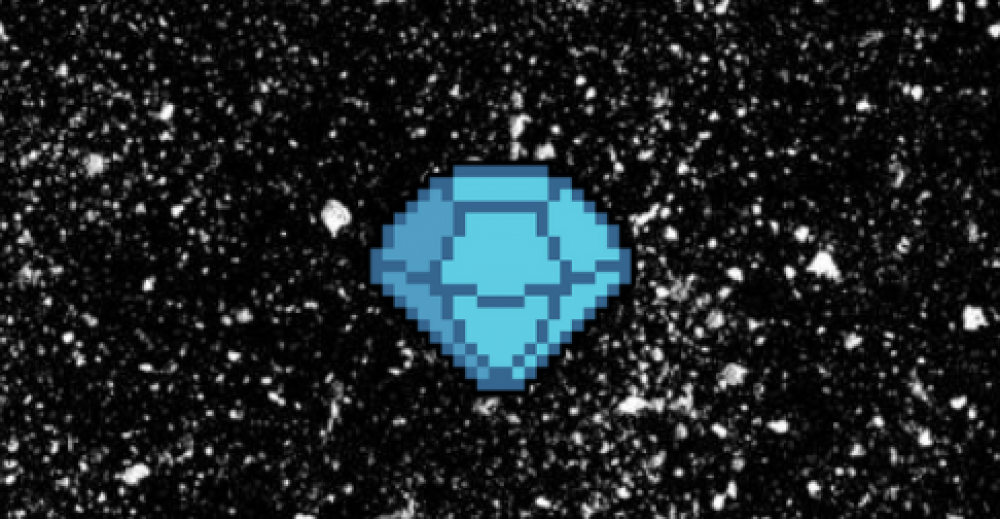
Uncut Gems #3 - Par-delà étrange et familier : le drone, la menace sourde
vendredi 21 novembre 2025Eerie music playing in the background
Et d’un coup je frissonne en écoutant ces notes qui se répètent.
Il y a quelque chose de terrifiant dans l’indicible, le non-palpable, l’invisible. Mes premiers chocs esthétiques, et ceux qui sont restés avec le temps, sont fondamentalement liés à ces concepts. Être attiré par les marges, l’irrégulier et l’expérimental, c’est aussi comprendre que ce qui fait vraiment peur se cache souvent dans l’obscurité, parfois sans jamais se dévoiler. Je l’ai compris au contact des David Lynch et Kyoshi Kurosawa, du surréalisme, du Horla, de Bruges-la-Morte, de Picnic at Hanging Rock et Possession… L’horreur me touche davantage quand elle prend des aspects magnétiques et métaphysiques. Cela vaut aussi pour la musique. Le black metal des années 90 par exemple a arrêté de nous faire peur, en tout cas à un niveau sonique : d’autres courants et esthétiques radicales ont depuis pris le relais (voir aussi notre article sur les musiques qui font peur, où je parle de Sunn O))) et Scott Walker).
Il n’y a pas que la peur dans tout cela, qui n’est qu’un sentiment parmi d’autres, un élément supplémentaire dans ce complexe rapport d’attraction-répulsion pour le bizarre. Mark Fisher en parle d’une très belle façon dans son ultime essai, Par-delà étrange et familier (2017), publié peu de temps avant sa mort. Comme à son habitude, il met sur le même plan des œuvres oubliées avec des classiques pop, analysant ce qu’elles disent de leur temps, en créditant la fiction. Toujours de façon horizontale, sans jamais prendre les auteurs de haut. Après avoir effleuré ces idées dans les numéros précédents, il me semblait donc indispensable de parler de l’étrange dans ce numéro d’Uncut Gems. Ou plus précisément, d’établir une distinction entre le bizarre et l’omineux (eerie, en anglais), deux concepts qui peuvent être rapportés à l’idée d’étrange et de familier, pour reprendre les définitions établies par Fisher.

Picnic at Hanging Rock (Peter Weir, 1975)
En simplifiant légèrement le propos, on pourrait résumer le bizarre comme un mode de présence, l’addition dans notre monde d’un élément qui dépasse les repères habituels. Les monstres de Lovecraft sont souvent bizarres précisément car ils ne ressemblent à aucun autre, tout en s’insérant dans des environnements généralement familiers. L’omineux se caractérise quant à lui par un rapport à l'absence : pensez à une forêt dans laquelle on n’entendrait aucun oiseau, aucun animal, aucune branche qui craque. Il devrait y avoir quelque chose et pourtant il n’y a rien. Ces deux concepts peuvent d’ailleurs coexister, lorsque certains éléments ne sont pas à leur emplacement habituel par exemple. Ou que d’autres, identifiés ou non, prennent justement leur place.
Je n’ai pas la prétention de poursuivre ici le travail de Fisher, d’appliquer exactement sa grille de lecture aux œuvres dont je parle. En revanche, je trouve que mettre les œuvres en relation les unes avec les autres est un travail essentiel, et permet ultimement d’identifier ce qui nous parle en elles. Cela peut avoir un rapport avec notre vie, au moment où l’on a découvert un album et comment notre appréciation de celui-ci a évolué, mais aussi parfois avec le seul pouvoir évocateur d’une œuvre d’art. Souvent, c’est un mélange des deux, quand une œuvre nous donne le sentiment de parler de quelque chose, qu’elle nous a accompagné à certains moments de notre vie, et que le tout se mêle dans une expérience singulière. Je suis persuadé que tout n’est pas qu’abstraction ou appréciation personnelle. Quelques éléments concrets traversent ainsi les albums dont je parle ici : l’utilisation du drone, des interférences, de la noise, comme éléments constitutifs de la musique, venant précisément troubler les perceptions, inquiéter, fasciner.
Mamiffer | Death Kneel | Nocturnal Emissions | Dawn Terry
Mamiffer - The World Unseen
Drone / Ambient / Post-Rock - USA
Le bourdonnement est l’élément central de la musique drone, et celui-ci n’est jamais complètement rassurant. J’aimerais néanmoins opérer une distinction : si l’on connaît le drone en tant que genre musical à part entière, dans lequel il occupe lui-même un rôle de premier plan, de nombreux autres artistes s’emparent de cette technique et l’incorporent à d’autres styles. Faith Coloccia et son mari Aaron Turner (Sumac, Isis, etc.) jouent de cette ambivalence dans leur groupe Mamiffer, et de l’alternance (ici, la complémentarité ?) entre le dérangeant et le lénitif. Le passage du morceau introductif à « Flower of the Field II » en est la parfaite incarnation, véritable mise en musique du moment où l’on rentre chez soi, au chaud, après avoir longtemps marché dans le froid de la nuit. Le passage, la transition. Et lorsque l’on ouvre la fenêtre un instant, que les poussières de la pièce s’envolent aspirées par le vent, celles-ci sont pareilles à tant de phalènes disparaissant dans l’obscurité.
Les segments de drone, bruitistes, et autres manipulations acousmatiques se greffent alors à une musique d’apparence noble. Sans la dénaturer, non, car il y a parfois aussi une beauté dans l’étrange. L’ensemble tient également dans son équilibre – donnez plus d’importance à un élément qu’à un autre et tout sera différent. La structure est la même mais le contenu semble évoluer à chaque écoute, métamorphose constante de morceaux que l’on redécouvre, comme une lampe à lave qu’on aurait laissée dans un coin de la pièce. La beauté prévaut parfois, vite remplacée par la tristesse, le deuil, le sentiment de submersion. « Mára » en est une très juste illustration, s'agrippant lentement aux cœurs, nous émouvant, tout en restant presque inquiétante d’un bout à l’autre.
La terreur se cache aussi derrière les plus beaux tableaux, et ces voix qui étaient un temps rassurantes deviennent pesantes, hantées. Ma chambre n’a pas changé depuis plusieurs années, les photos sur les murs sont les mêmes, censées être inaltérables comme les souvenirs qu’elles illustrent. Pourtant, tout est différent aujourd’hui. La nuit est différente, les souvenirs sont différents, et le froid s’invite à l’intérieur. Lorsque le disque progresse, et que le drone remplace le piano, c’est alors comme si des forces extérieures, des agents étrangers, prenaient le contrôle. Tous, venus détruire la beauté, le confort, la stabilité. L’abysse n’est jamais très loin, et se trouve souvent déjà en nous. La deuxième face du disque, autour de la trilogie « Domestication of the Ewe », est comme une ultime mise à l’épreuve, avec trois morceaux qu’on ne s’approprie jamais vraiment.
The World Unseen, l’invisible, ou plutôt ce qu’on n’a jamais vraiment voulu voir, parfois pendant des années. Pourtant, tout était déjà là dans le titre.
------
Death Kneel - Beyond Manilla
Death Industrial - Canada
Pour les musiques bruitistes, il y a un avant et un après Going Places, l’album de Yellow Swans sorti en 2010 et qui a tout changé. Quarante minutes qui ont montré que le rêve pouvait s’incarner dans le bruit, que nos préconceptions autour des musiques extrêmes pouvaient être facilement pulvérisées. Revenir à l’essentiel, l’origine du son et ce que les textures nous procurent en termes d’émotion. Le disque n’est pas tombé du ciel pour autant : il est l’aboutissement d’un mouvement en lame de fond qui a exploré, des années durant, les limites de ce qu’on pouvait faire en mélangeant les instruments aux machines. Aux confins de l’indus, du metal, et des musiques électroniques. J’en parlerai un jour, davantage, en donnant à l’album toute la place qu’il mérite.
Death Kneel n’en est pas très éloigné, par ailleurs un des nombreux projets du batteur-chanteur de Tomb Mold, Max Klebanoff. Il me semble aussi l’héritier de nombreux groupes death industrial, doté néanmoins d’une singularité remarquable. Ici, plusieurs références à des lieux connus ponctuent les morceaux (Philippines, Russie), comme un carnet de voyage douloureux qui ne révèle jamais ses secrets. Dans son livre, Mark Fisher parle également du rapport qu’entretiennent bizarre et omineux avec le concept d’un « en-dehors ». Certaines œuvres sont hantées par ce qu’il se passe en-dehors d’elles, lorsque les indices glissés dans la musique ne sont pas suffisants pour donner à l’auditeur un semblant d’explication. On reste là avec des questions : que s’est-il passé aux Philippines, en Russie ? Qui est venu détruire ces paysages, rompre la contemplation ?
Beyond Manilla, comme les autres albums de cette sélection, est marqué par un sens de la reconfiguration permanente. Les synthétiseurs, pads au premier plan peuvent apparaître bien tranquilles avant d’être transpercés, déchirés par des cris qui sont comme autant de rayons anticrépusculaires à l’origine mystérieuse. L’ivresse de l’instant fait place à la peur de perdre le contrôle. On entend des pleurs à la fin du dernier titre, et le fait que l’on ne sache jamais si ceux-ci sont simulés, samplés, ou alors captés sur le vif durant l’enregistrement est profondément troublant. Parfois aussi, en art et ailleurs, il est peut-être sain de ne pas avoir toutes les réponses.
------
Nocturnal Emissions - Spiritflesh
Ambient / Indus - Royaume-Uni
L’idée de montage a quelque chose de profondément bizarre. Prenons-le simplement, c’est-à-dire comme l’addition de plusieurs éléments pas nécessairement assemblés au départ. Il est une nouvelle façon de concevoir un objet, voire des objets, que l’on superpose et modifie. Dans certains cas, leur portée politique apparaît immédiatement : c’est toute la puissance du travail opéré par des artistes comme John Heartfield, pionnier du photomontage popularisé par ses détournements de la propagande nazie. Parallèlement, lorsque l'on regarde ses œuvres de près pendant plusieurs minutes, il devient difficile de se défaire d’une certaine sensation de malaise. En isolant des bouts de réalité pour en faire autre chose, se débarrassant au passage de toute vraisemblance pour créer un objet nouveau, le bizarre apparaît à l’état pur : troublant la réalité, comme une anomalie dans le champ de vision.
Une sensation similaire m’envahit avec de nombreuses œuvres tirées de la musique industrielle. Dès les pochettes, souvent, comme c’est le cas avec l'album Spiritflesh, ainsi qu’avec d’autres groupes comme Ramleh et Genocide Organ, pour citer les plus connus. Cette sensation se fait plus oppressante, encore, lorsque des photos de paysages ou de portraits sont isolées, rendues presque inidentifiables, anonymes, parfois avec une colorimétrie modifiée. Le déplacement opéré brouille les pistes, et sa portée n'est plus simplement esthétique. Nocturnal Emissions est le projet de l’artiste anglais Nigel Ayers (la très recommandable Catherine K. en a aussi fait partie, entre autres), lui-même un pionnier du digital sampling et du sound collage. Tant de variations autour du montage, finalement, de l’assemblage appliqué à la musique comme aux visuels.
Le disque est caverneux et inquiétant, bien avant les incarnations actuelles du dark ambient, souvent en parodie de lui-même. Si il est difficile de donner une définition exacte de la musique industrielle, c’est précisément car elle est l’addition d’éléments qui ne vont pas ensemble au départ. Parmi ceux-ci, il y a la présence de sons qui évoquent l’aspect « industriel », aux côtés de synthétiseurs froids qui rappellent le toucher du métal, et de samples variés, on y revient. Alors que les ambiances sont parfois reléguées à l’arrière-plan dans ces styles-là, Spiritflesh opère un mouvement inverse en les remettant au premier plan. Et d’un coup, on se rend compte de tout ce qui ne va pas. On entend des sons d’animaux, de la nature, et de ce qui ressemble à des humains s'adonnant à des rituels divers. Mais chaque enregistrement est transmuté, tordu, altéré, venu se dissoudre dans la musique comme autant de corps se décomposant avant de ne faire qu’un avec le sol. Le récit d’un voyage ethnographique maudit, Claude Lévi-Strauss en enfer.
------
Dawn Terry - Sorrow
Dungeon Drone - Royaume-Uni
Il y a un vrai feeling anglais à plusieurs musiques, lorsqu’elles semblent dépeindre certains paysages hantés. Les mêmes que l’on retrouve dans la musique de Coil par exemple, comme dans les moyen-métrages folk horror de la BBC des années 60-70. Sur ce premier aspect, il est difficile de ne pas penser ici aux dernières productions du duo Balance/Peterson, avec l’accordéon de « My Friends, You Are Shining Pillars of Light » et ces boucles sublimes qui créent la transe. Du reste, la première partie de Sorrow pourrait être la BO des films « Whistle and I’ll Come to You » (1968) et « A Warning to the Curious » (1972), tous deux adaptés de nouvelles de l’écrivain M.R. James. Dans ces deux œuvres, l’exhumation d’objets anciens est au cœur du récit, amenant des troubles paranormaux pour les personnages. Mais ces films, évoqués par Fisher, sont aussi une réflexion sur les paysages de la côte Est de l’Angleterre, ces ports florissants et ces villes propices devenus des dunes désertes, des plaines de solitude entre deux stations de train que l’on croirait désaffectées. La menace plane, avant et après l’exhumation, mais ne se montre jamais clairement – comme dans chacun des morceaux où règne une tension permanente, la peur de ce qui pourrait surgir à tout moment.
J’en parlais précédemment – les œuvres rangées dans le « dungeon synth », dans leur ensemble, ont souvent peu de choses en commun entre elles. Les contours de cette scène ont été dessinés durant des décennies par des musiciens aux influences variées, des fans de Mortiis et Summoning, aux musiciens ritual ambient ou progressive electronic. Dawn Terry a elle aussi expérimenté au sein de plusieurs marges, et d’abord comme musicien des projets Trollmann av Ildtoppberg et Bong, où le drone occupe une place centrale, primordiale. Pour ce disque, ce sont trois morceaux, comme trois pièces distinctes, où demeure une même sensation d’ampleur, de représentation des grands espaces. Ces paysages vastes, ouverts et dépouillés, au fond typiquement anglais. Si l’on considère qu’il n’y a plus rien dans ces espaces, c’est bien que l’on accepte l’idée qu’un jour il s’y trouvait quelque chose. La peur se glisse aussi dans cet espace de l’absence, où figure une menace sourde et impalpable.
Le dernier titre présente une atmosphère bien différente des deux premiers, axée autour d’une progression lente et lancinante, où les souvenirs des batailles passées ressurgissent par le son des percussions martiales. Ces artefacts déterrés ont un propriétaire - pourrait-il revenir nous hanter ? Par ailleurs, que s’est-il passé ici ? Quelle est l’origine de ces ruines, de l’absence de vie ? L’écoute attentive nous transporte ailleurs, vers des terres lointaines et étranges où apparaissent des souvenirs qui ne sont pas les nôtres. Devant nous, un vieux lac, duquel une armée spectrale sort, patrouille, avant de retourner à son sommeil. Des corps en rang, à l’horizon, des lumières de couleur jade qui en émanent. Ces âmes n’ont jamais vraiment trouvé le repos, comme les soldats bleus du Dreams d’Akira Kurosawa.
Alors faisons le trajet retour, pour retrouver le lieu de l’artefact et l’y enterrer. Mais si je le fais, et que la musique s’arrête, est-ce que la menace disparaîtra pour de bon ?
------
« Le miroir se brise, je suis un autre, et je l’ai toujours été »
Cette phrase de Fisher rebat les cartes. Si le bizarre et l’omineux troublent autant qu’ils attirent, c’est précisément par leur remise en question de nos conceptions de la réalité. C’est l’idée finalement que l’on puisse perdre le contrôle sur le cours des choses, du monde, et peut-être même de nos êtres. Si des forces extérieures, structurantes et magnétiques sont capables de tout changer, pourquoi nos destins seraient-ils épargnés ?
Ces aspects deviennent fascinants en art quand se matérialise un rapport d’horizontalité aux éléments étranges. La force d’un Lynch est d’avoir tout mis au même niveau, les apparitions métaphysique, les personnages fantasmés, et le quotidien en apparence insignifiant de dizaines de gens. Dans un monde où les règles du normal semblent bousculées, chaque interaction peut alors nous sembler décalée, curieuse ou inquiétante. Tout est reconfigurable en permanence, si l’on ajoute ou l’on supprime des éléments : Eraserhead semble changer de mode narratif, de langage, toutes les cinq minutes ou presque. On revient ultimement à la notion d’espace, de l’absence de ce qui devrait être, et de ce qui n’est pas à sa place (out of place). La musique peut recréer cette sensation d’espace, de densité, d’ouverture, ou de resserrement. L’ambiguïté de nos ressentis face à une œuvre d’art se joue aussi dans ce rapport à l’espace, de ce qu’on y voit, d’où on se situe par rapport à lui.

Whistle and I'll Come to You (Jonathan Miller d'après une histoire de M.R. James, 1968)
Le brio de Mark Fisher, sur ce sujet comme sur plein d’autres, est d’avoir su donner à la fiction toute l’importance qu’elle mérite. C’est-à-dire, de lui offrir une place de premier rang, partir d’elle pour tenter ensuite de comprendre les intentions de l’auteur et sa place dans l'époque. Il ne faut pas oublier le métatexte, mais il ne doit jamais prévaloir, car il donne de la substance à la fiction et pas l’inverse. Finalement, c’est l’affaire de prendre au sérieux les œuvres que l’on aime, de s’y plonger pour les raisons qui nous parlent intimement. La suite, les explications, viendront naturellement. J’ai ressenti des choses bizarres en écoutant Spiritflesh - je n’étais pas surpris d’apprendre ensuite que Nigel Ayers avait pleinement exploré dans son travail les effets du son sur la psyché, quoi que cela veuille dire concrètement.
On peut choisir d’ignorer le bizarre, d’une part, comme une hallucination inversée pour se protéger. En quelque sorte, s’auto-persuader que l’on n’a pas vraiment vu ce qui vient pourtant de se passer sous nos yeux. Finalement, on n’est pas si loin des mécanismes de défense décrits par Georg Simmel (Les grandes villes et la vie de l’esprit) : la grande ville, dont il prend l'exemple, est bourrée de stimuli, et pour se protéger, pour ne pas être broyé par la violence de ce qui nous entoure, il faut s'accommoder aux sollicitations continuelles et ne pas les vivre sur un mode sensible. Une façon d’effacer inconsciemment tout élément hétérogène de notre vision périphérique, de former une nouvelle abstraction. Le bizarre constitue ainsi l’objet-même de la fascination, celui que l’on regarde ou que l’on ignore. Pour l’omineux, le vide créé par l’absence devient un espace vers lequel on projette ses propres peurs ou sa curiosité. Tant d’éléments qui interrogent finalement nos positionnements affectifs face aux objets du quotidien, et ultimement à l’art.
L’étrange interroge nos perceptions, et les disques les plus fascinants sont ceux que l’on peut redécouvrir avec cette grille de compréhension. Si une musique nous hante, au sens premier du terme, c’est qu’elle cache parfois des secrets invisibles à la première écoute. Le drone en fond en est l’incarnation sans équivoque - objet sonore en devenir, créateur d’une tension qui n'explose pas forcément.
*
* *
J'espère que cette sélection vous a plu. En attendant la prochaine, vous pouvez me suivre ponctuellement sur Horns Up, sur l'émission Horns Up, et via mes réseaux (@chevaldeglace).
- Uncut Gems #1 - Metalcore mélodique, dungeon synth nordique, et autres EPs oubliés
- Uncut Gems #2 - Mike Patton, l'Exotica, et le Dieu venu du Centaure